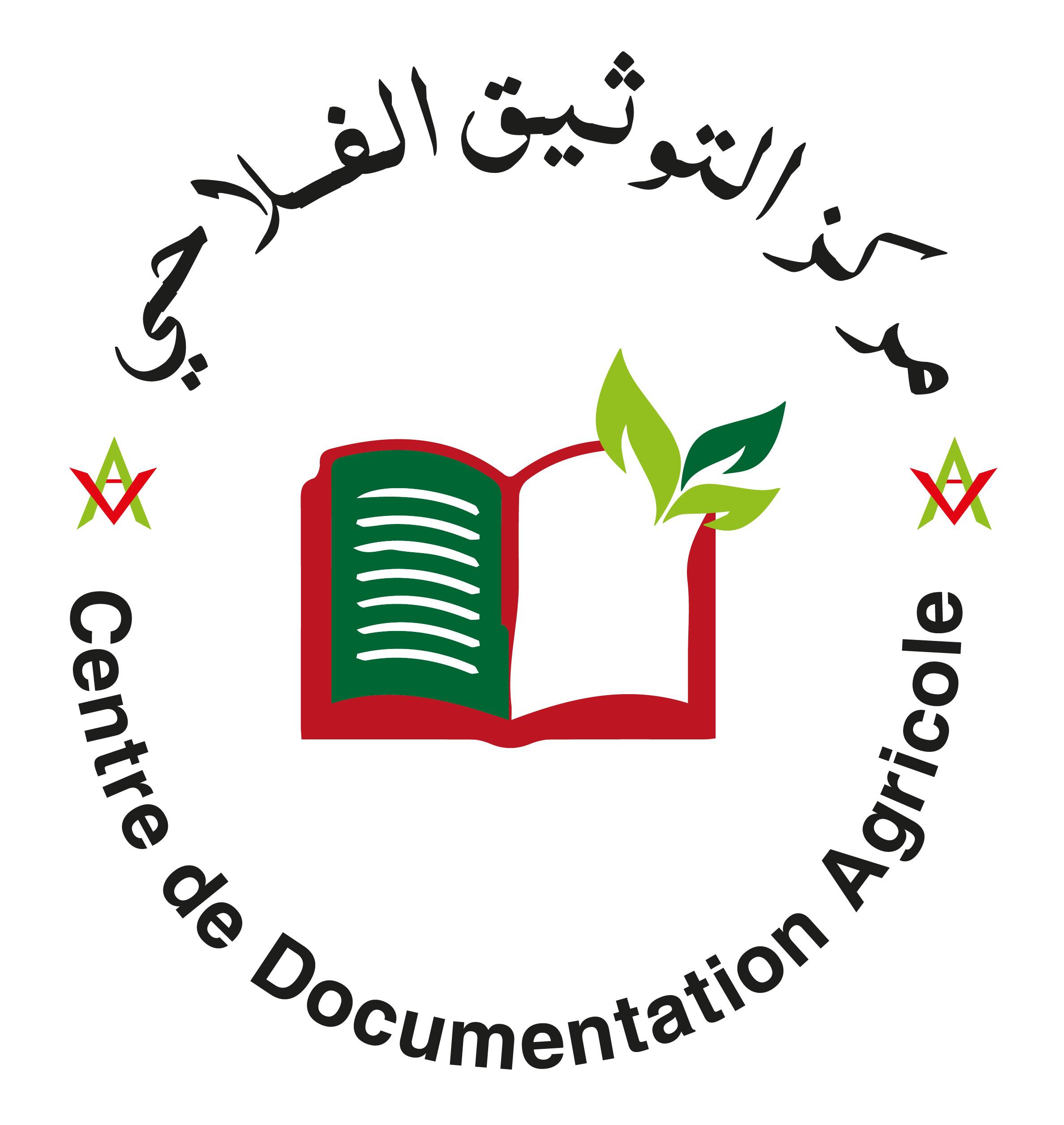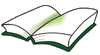|
Résumé :
|
La sécheresse cause annuellement une perte de 40 ŕ 60 % des productions agricoles mondiales. Au Maroc, les ressources hydriques sont potentiellement limitées et le problème de la pénurie d'eau s'accroi#9#t de plus en plus. Dans le domaine des productions végétales, il s'agit de bien valoriser chaque m3 d'eau en faisant une gestion intégrée des eaux de pluie et d'irrigation. Cette étude abonde dans ce sens et se propose donc de contribuer ŕ l'établissement de références essentielles et capitales pour un pilotage hydrique optimal sur les cultures du blé et de la pomme de terre. Nous nous sommes fixés les objectifs spécifiques de déterminer, selon le cultivar, les doses et les stades d'apport qui génèrent les efficiences d'utilisation de l'eau les plus grandes, puis de caractériser les mécanismes agro-physiologiques qui déterminent les niveaux de rendement et de résistance ŕ la sécheresse. Dix expérimentations ont été menées dans les conditions de plein champ ainsi que sous serres. Le premier volet de l'étude, axé sur la culture du blé tendre, montre qu'une seule irrigation, au tallage pour les variétés ŕ faible capacité de tallage, comme Potam et Marchouch 8, ou ŕ l'épiaison pour les variétés ŕ fort coefficient de tallage, comme Tegey, peut engendrer des augmentations de rendement allant jusqu'ŕ 100% du régime pluvial et permettant ainsi une amélioration dans l'efficience d'utilisation de l'eau allant jusqu'ŕ 70%. L'étude montre également que lorsque deux irrigations d'appoint peuvent e#5#tre envisagées, il est toujours plus productif et plus efficient d'appliquer la première autour du tallage quelque soit le stade de la seconde. Par ailleurs, un apport hydrique unique et tardif, au cours du grossissement du grain, n'améliore pas toujours les rendements de manière significative et peut par conséquent diminuer les niveaux de l'efficience d'utilisation de l'eau par rapport au témoin pluvial. L'analyse agrophysiologique montre que l'intére#5#t des irrigations précoces, réside dans leur capacité ŕ améliorer le nombre de grains/m2, ŕ augmenter le niveau maximum de l'indice foliaire (LAI), ŕ allonger la durée d'action de la surface foliaire (LAD) et ŕ permettre la réalisation d'un niveau élevé de matière sèche ŕ l'anthèse. Le second volet de l'étude, portant sur la culture de pomme de terre, montre qu'un stress hydrique transitoire réduit d'autant plus le rendement en tubercules que son stade d'occurrence est précoce. Ainsi, c'est le stress hydrique de la pré-tubérisation qui est le plus déterminant avec des chutes pouvant atteindre 35%. L'étude montre par ailleurs qu'un arre#5#t complet de l'irrigation ŕ partir de la maturation permet une efficience d'utilisation de l'eau plus grande que celle du témoin non stressé. En outre, lorsqu'un stress hydrique significatif a été imposé de manière continue, l'ampleur de ses effets ainsi que les paramètres affectés ont varié selon les cultivars. De plus, les cultivars les plus productifs en conditions irriguées peuvent e#5#tre les moins performants en situation de stress hydrique. Ceci a été le cas pour Remarka qui a exprimé l'indice de tolérance ŕ la sécheresse (TDWS) le plus bas. Le TDWS de cette variété n'a en effet pas atteint les 62%, tandis que chez Désirée, cet indice a approché les 90%. Les variables qui ont déterminé les niveaux de rendement ont été le LAI maximum pour le champ et la serre, et la masse racinaire, qui n'a eu d'effet qu'au champ. Par ailleurs, les niveaux de tolérance ŕ la sécheresse ont été positivement corrélés ŕ la capacité de maintenir le taux de croissance des tubercules au début du grossissement (champ et serre), ainsi qu'ŕ la possibilité d'augmenter la profondeur d'enracinement (champ) en cas de stress hydrique. Ces deux éléments expliquent la résistance élevée ŕ la sécheresse chez Désirée.
|