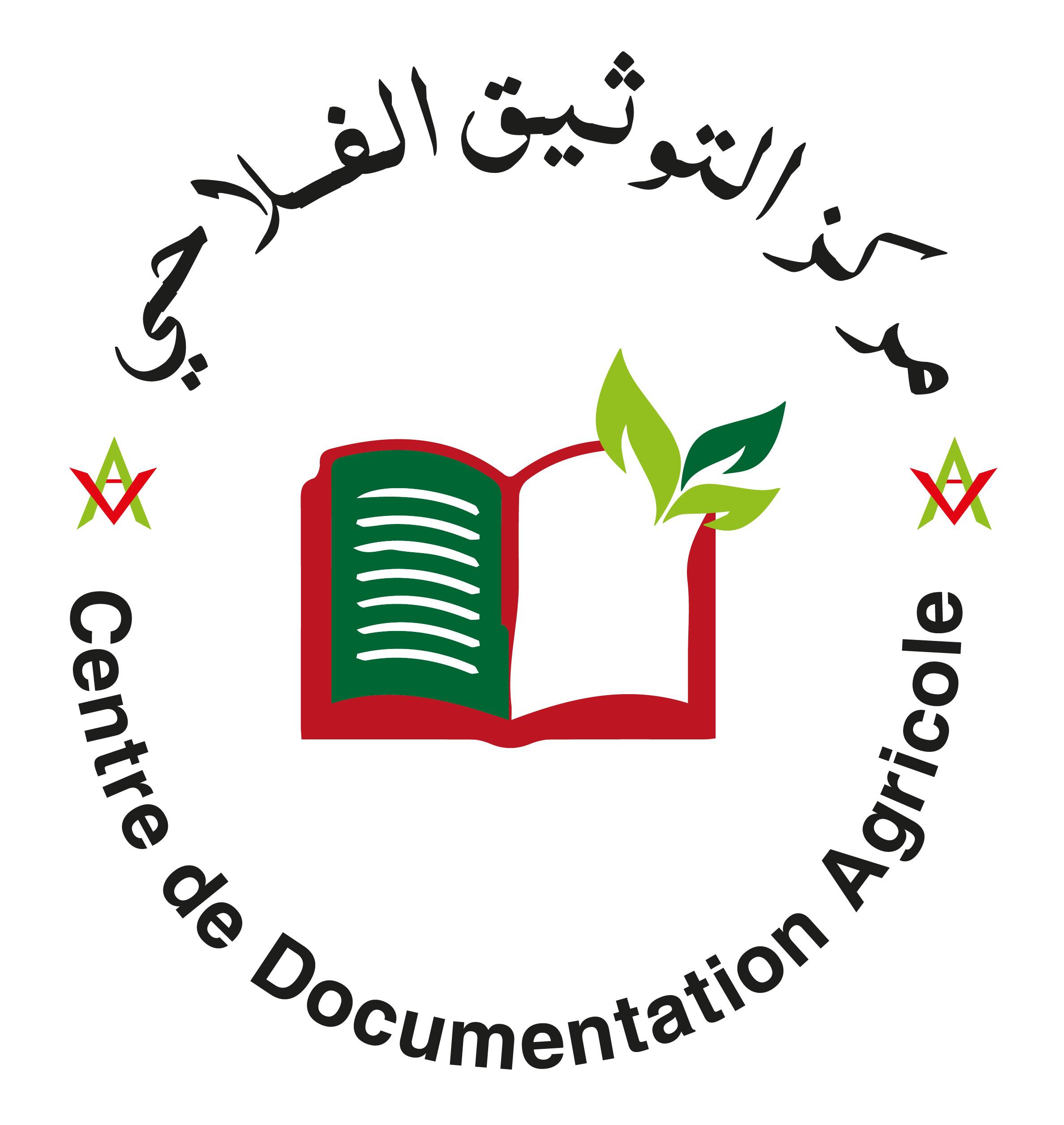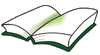|
Résumé :
|
L’érosion hydrique constitue l’un des principaux processus de dégradation des sols au Maroc, affectant négativement la productivité agricole, la qualité des eaux et la durabilité des aménagements hydrauliques. Dans le bassin versant amont du barrage Allal El Fassi, situé dans le bassin du Sebou, cette problématique est accentuée par la combinaison de facteurs naturels et de pressions anthropiques. Ce travail vise à évaluer l’évolution de l’érosion hydrique entre deux périodes distinctes (1990–2010 et 2010–2017) et à analyser l’efficacité des aménagements antiérosifs mis en place, en combinant les Systèmes d’Information Géographique (SIG), le modèle RUSLE et le taux de délivrance des sédiments (SDR), avec validation par données bathymétriques. Le modèle RUSLE a été appliqué à partir des cinq facteurs d’érosion : l’érosivité des pluies (R), l’érodibilité des sols (K), le facteur topographique (LS), le couvert végétal (C) et les pratiques de conservation (P). Chacun a été cartographié pour les deux périodes étudiées. Les résultats montrent une diminution de la perte en sol moyenne de 3,05 t/ha/an à 1,7 t/ha/an, accompagnée d’une progression de la classe d’érosion faible (0–2 t/ha/an) de 65,54 % à 79,63 % de la superficie totale, et d’une réduction des classes d’érosion forte à extrême. Cette baisse est en grande partie liée à la diminution du facteur R, passée d’un intervalle de 385,14–705,09 MJ·mm·ha⁻¹·h⁻¹·an⁻¹ à 332,49–615,65 MJ·mm·ha⁻¹·h⁻¹·an⁻¹, et à l’implantation d’ouvrages mécaniques, principalement des seuils en gabion. L’évaluation du rendement sédimentaire par intégration du SDR confirme une baisse généralisée dans la majorité des sous-bassins, notamment dans les sous-bassins 4 et 6 où la dégradation spécifique est passée respectivement de 6,28 à 2,83 t/ha/an et de 6,13 à 2,89 t/ha/an. La comparaison avec les données bathymétriques a révélé une bonne concordance, avec une dégradation spécifique calculée de 3,87 t/ha/an contre 4,49 t/ha/an mesurée, soit un écart de 0,62 t/ha/an. En revanche, le facteur C indique une dégradation du couvert végétal durant la seconde période, avec plus de 95 % de la superficie dans la classe (0,8–1), ce qui traduit une efficacité limitée des aménagements biologiques à court terme, en raison de leur implantation localisée, du temps nécessaire à leur effet et des pressions anthropiques persistantes (surpâturage, déboisement). Ces résultats mettent en évidence l’efficacité des ouvrages mécaniques à effet immédiat, mais soulignent la nécessité de renforcer et de protéger les interventions biologiques pour garantir une réduction durable de l’érosion. Ils confirment également l’intérêt de combiner modélisation, SIG et mesures bathymétriques pour évaluer et suivre les dynamiques érosives dans un contexte de gestion intégrée des bassins versants.
|