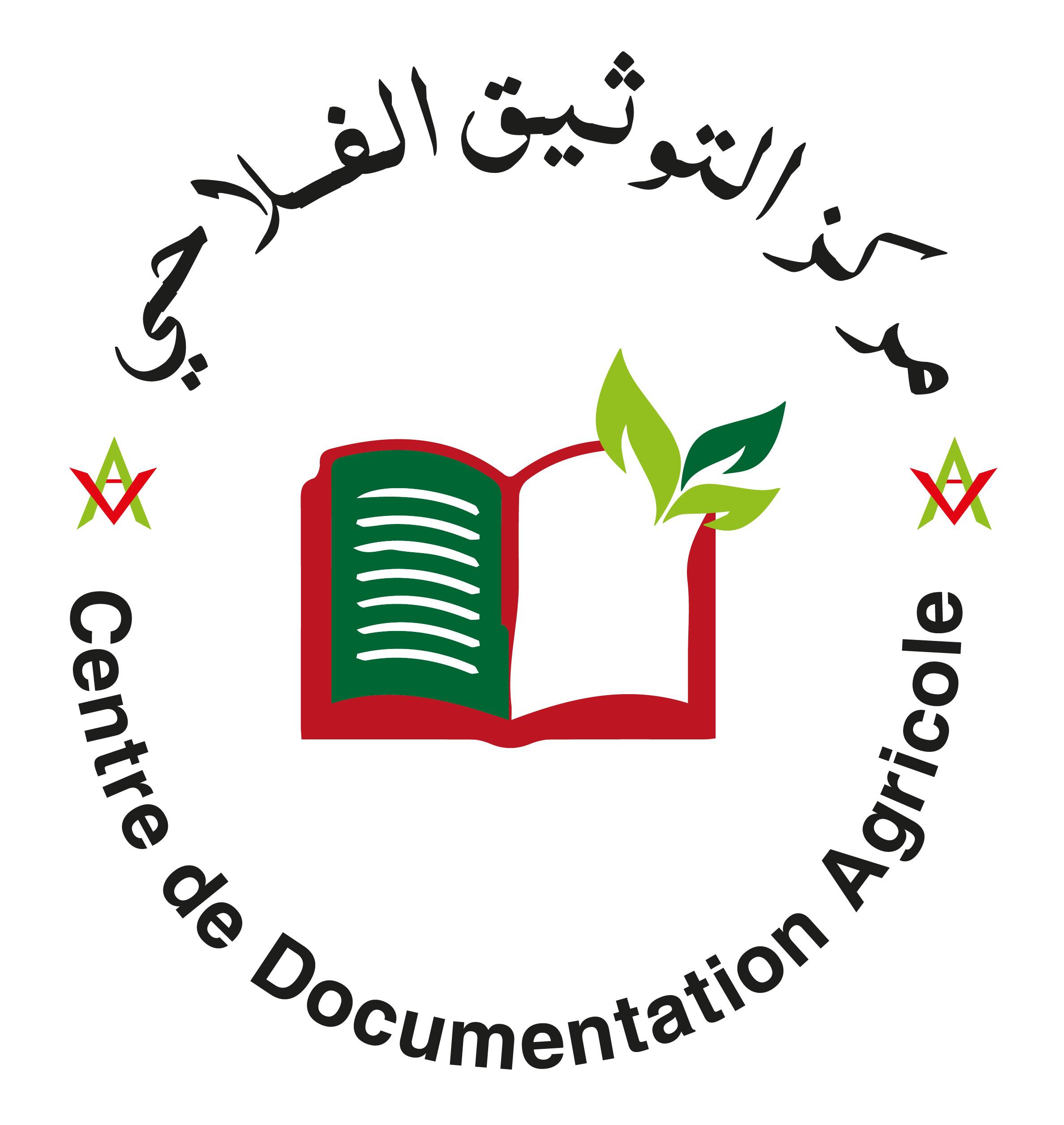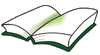|
Résumé :
|
Dracocephalum ruyschiana L., espèce alpine rare appartenant à la famille des Lamiaceae, est fortement menacée par la dégradation de ses habitats et sa faible capacité de régénération naturelle, justifiant des efforts urgents de propagation ex situ. Cette étude visait à établir des protocoles robustes in vitro et sur semence pour la multiplication et la conservation de cette espèce. Deux systèmes expérimentaux complémentaires ont été mis en œuvre : culture de segments nodaux selon deux régimes thermiques (substrat chauffé à la base vs. chambre climatique contrôlée) combinés à différentes concentrations du milieu d’Anderson (plein, demi, quart) ; germination de semences évaluant des traitements exogènes de l’acide gibérellique (GA₃) et des nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnO) à diverses concentrations. Pour l’expérience in vitro, la survie, l’induction des pousses, le pourcentage d’enracinement et la cinétique d’enracinement ont été mesurés ; dans l’essai semis, les variables étudiées comprenaient la proportion de germination, le temps moyen de germination (MGT) et la vigueur des plantules (longueur de racine). Les données ont été analysées par ANOVA avec contrastes post hoc, et les interactions entre régime thermique et concentration du milieu ont été examinées. Nous avons observé que le chauffage basal associé au milieu Anderson à demi-force a permis un enracinement de 100 % soit une augmentation de 93 à 99 % par rapport aux autres traitements et a accéléré l’initiation racinaire de 22 % (38 vs 49 jours). Dans l’essai de germination, le traitement à 10 ppm de ZnO a engendré 50 % de germination, soit des gains de 38 % par rapport au GA₃ et +50 % par rapport au témoin ; les plantules soumises à ZnO ont également présenté la plus grande longueur racinaire (3,3 cm) et un MGT réduit à 35 jours (7 jours plus tôt que GA₃ et 43 jours plus tôt que 100 ppm ZnO). Ces résultats démontrent que l’ajustement conjoint des régimes nutritionnels et thermiques, associé à l’utilisation raisonnée de nanoparticules, permet de surmonter d’importantes contraintes physiologiques à la propagation. Ils fournissent ainsi une base solide pour des stratégies innovantes de conservation ex situ et la valorisation durable d’espèces rares.
|