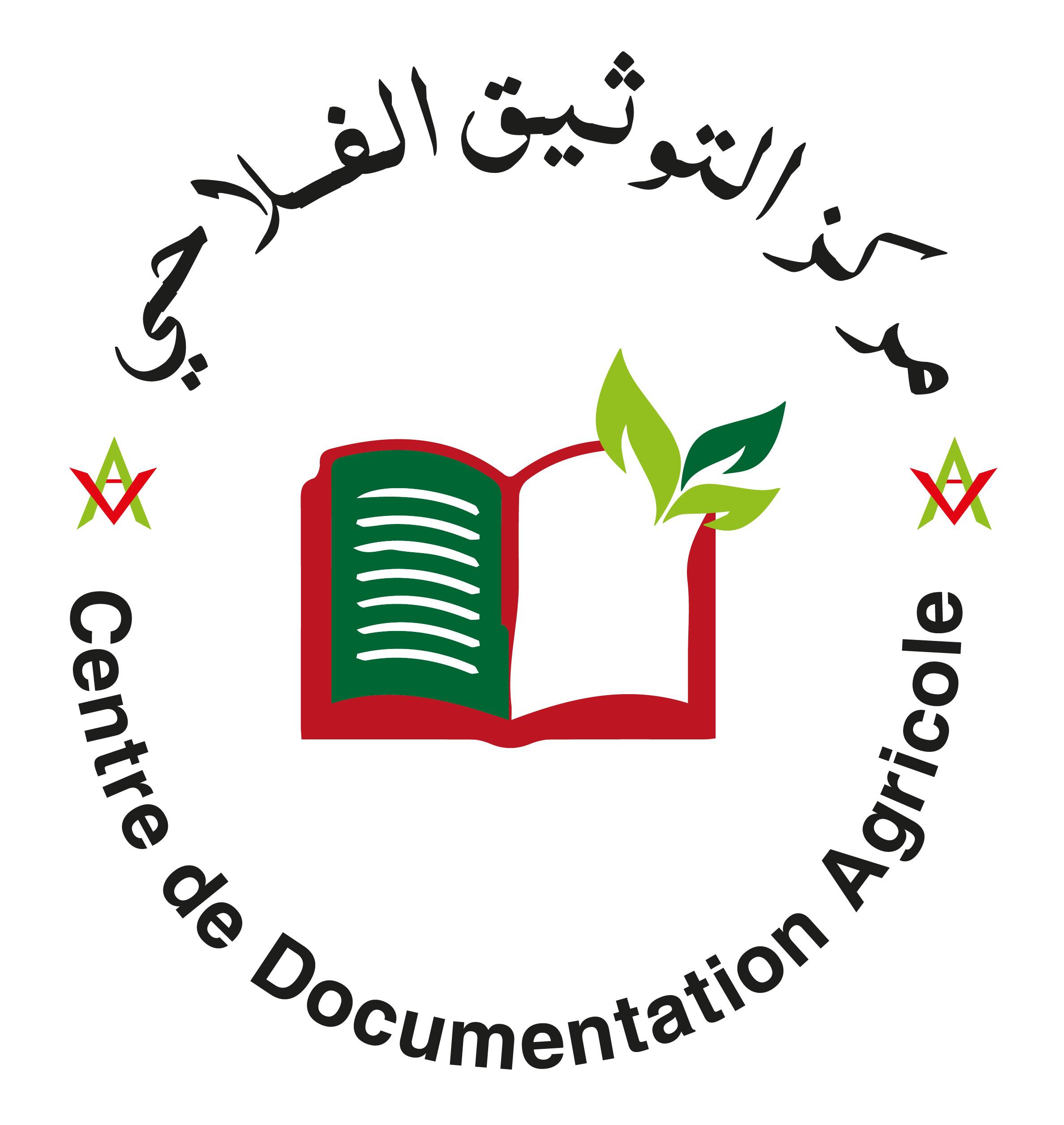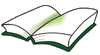|
Résumé :
|
Face à la dégradation progressive de la qualité de l’eau brute du barrage SMBA, notamment en lien avec les phénomènes d’eutrophisation et la formation de sous-produits de désinfection tels que les THM, la station de traitement du Bouregreg a intégré une filière de pré-ozonation en remplacement de la pré-chloration. Ce travail vise à évaluer les performances de cette technologie selon une approche multidimensionnelle : qualité de l’eau, efficacité technique et viabilité économique. L’analyse des paramètres physico-chimiques a révélé une meilleure maîtrise du pH, avec une valeur moyenne abaissée de 7,65 en 2024 à 7,56 en 2025, grâce à une acidification contrôlée par l’acide sulfurique. Cette régulation fine a permis une réduction moyenne de 8,9 % des doses de coagulant injecté, optimisant la coagulation. Du point de vue de la qualité sanitaire, l’introduction de l’ozone a permis de réduire fortement les concentrations de THM, avec des baisses allant jusqu’à -61,8 % pour le DCB. Toutefois, le bromoforme a connu une légère augmentation de 19,4 %, tout en restant bien en dessous des normes. Sur le plan opérationnel, les résultats ont montré une hausse du nombre de lavages des filtres à sable, avec des augmentations de 13,5 % à 22,1 % selon les stations, traduisant un colmatage plus fréquent possiblement lié à la transformation de la matière organique par l’ozone. Par ailleurs, le coût global de traitement est passé de 0,183 Dh/m³ à 0,198 Dh/m³, soit une hausse de 8,2 %, due principalement aux investissements dans de nouveaux réactifs (oxygène, acide, soude) et à une consommation énergétique accrue sur le poste de préozonation (1,2 Mdh sur cinq mois). Ces résultats confirment que la pré-ozonation constitue une solution performante pour la maîtrise des sous-produits chlorés et l’optimisation de certaines étapes du traitement. Toutefois, son intégration doit être soigneusement ajustée pour éviter des effets indésirables comme le colmatage prématuré des filtres. La pérennisation de cette technologie passera par une adaptation progressive des pratiques opérationnelles, une meilleure gestion des biofilms, et, potentiellement, l’ajout d’un traitement adapté comme le charbon actif.
|