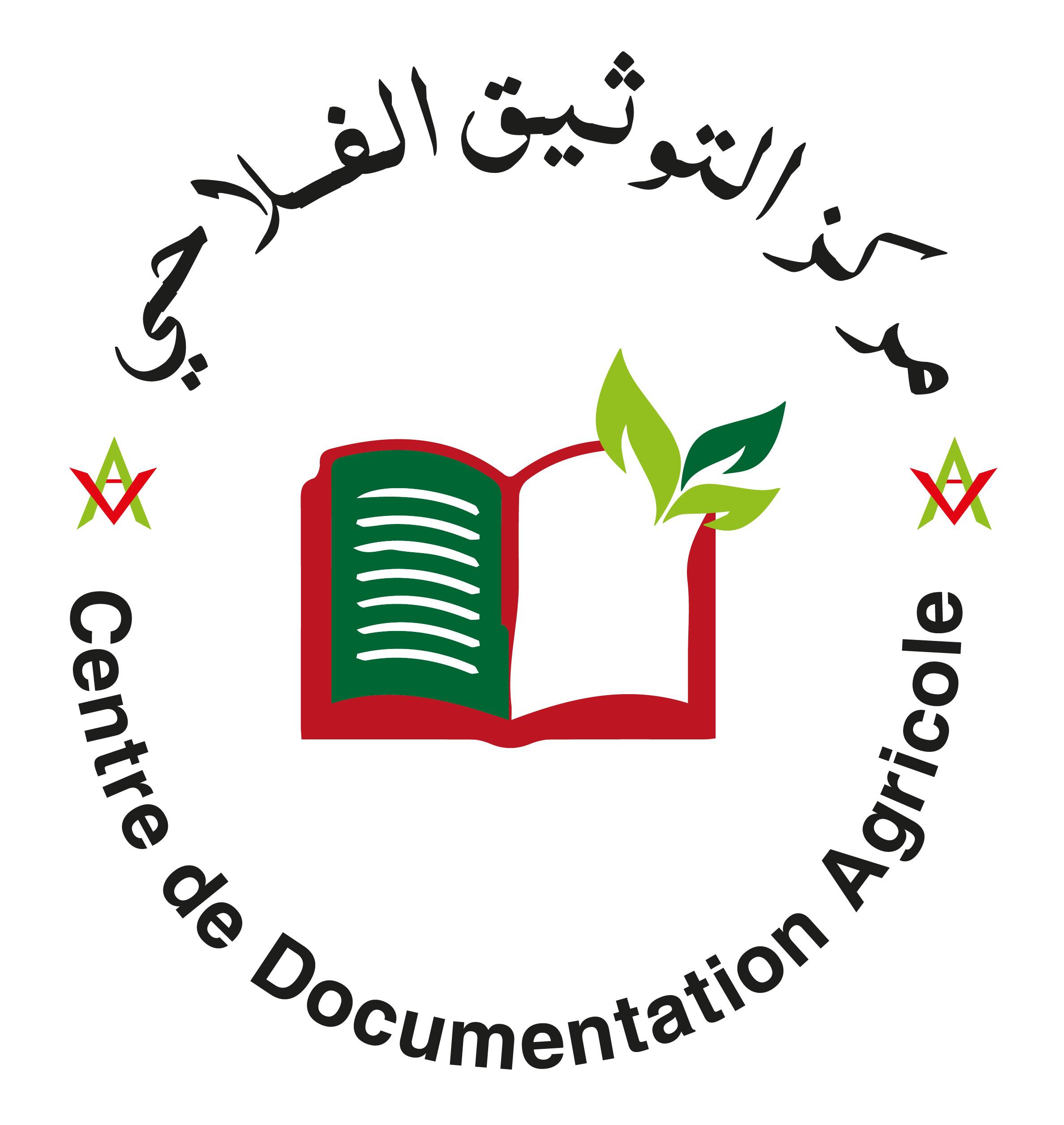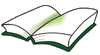|
Résumé :
|
Les espèces végétales pastorales jouent un rôle important dans l’alimentation des ovins conduits sur parcours. Leur diversité d’une zone à une autre et leur variabilité saisonnière, offrent aux animaux une ressource alimentaire valorisable de point de vue nutritionnelle mais aussi en termes de charges d’alimentation réduites pour les éleveurs. Cette étude a visé à différencier et classifier 20 espèces pastorales (Anabasis Aphylla, Anacyclus x Valentinus, Artemisia Herba Halba, Astragalus Hamosus, Atractylis Sarratuloides, Atriplex Nummularia, Avena Sterilis, Diplotaxis Harra, Eruca Sativa, Hordeum Murinum, Lygeum Spartum, Malva Parviflora, Papaver Dubium, Peganum Harmala, Plantago ovata, Rumex Pulcher, Salsola Vermiculata, Sonchus Asper, Stipa Tenacissima, Vicia Monantha Retz) selon leur composition biochimique et leur qualité nutritionnelle. Pour ce faire, trois approches ont été combinées : l'analyse chimique comme méthode de référence fiable ; la spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR), comme méthode de prédiction rapide ; ainsi que les perceptions et savoir écologique local des éleveurs en matière de disponibilité, de qualité et d’utilisation des ressources pâturées. Bien que les trois méthodes se soient avérées efficaces pour évaluer la qualité des espèces pastorales en tant que fourrages, elles ont montré des différences en termes de concordance et de précision nutritionnelle. L'analyse chimique demeure la méthode de référence la plus fiable pour déterminer la composition biochimique des plantes. En comparaison, la spectroscopie proche infrarouge (SPIR) fournit une estimation rapide des composants biochimiques (MAT, CB, NDF, ADF, ADL, cendres), mais elle reste une méthode prédictive dont la précision peut être facilement biaisée si l'espèce analysée présente une importante variabilité non prise en compte par le modèle de calibration. La perception de l’éleveur est une approche qualitative précieuse pour caractériser l'utilisation des plantes, mais sa fiabilité est limitée par sa nature subjective, intégrant des facteurs difficilement mesurables en laboratoire. La comparaison entre les classes qualitatives issues de la méthode chimique et de la SPIR a montré des résultats satisfaisants, avec une précision de 95 % et un coefficient Kappa de 0,91. Toutefois, l'application de ce modèle de classification à une base de données plus large exigerait une nouvelle calibration avec des résultats réels d'une plus grande diversité d'espèces, afin de garantir sa robustesse. En revanche, la comparaison entre la classification selon le profil biochimique et la perception des éleveurs a révélé une opposition marquée (précision = 35 % ; Kappa = -0,15). Cette discordance s’explique principalement par la différence des critères utilisés pour classer les espèces dans chacune des deux approches.
|