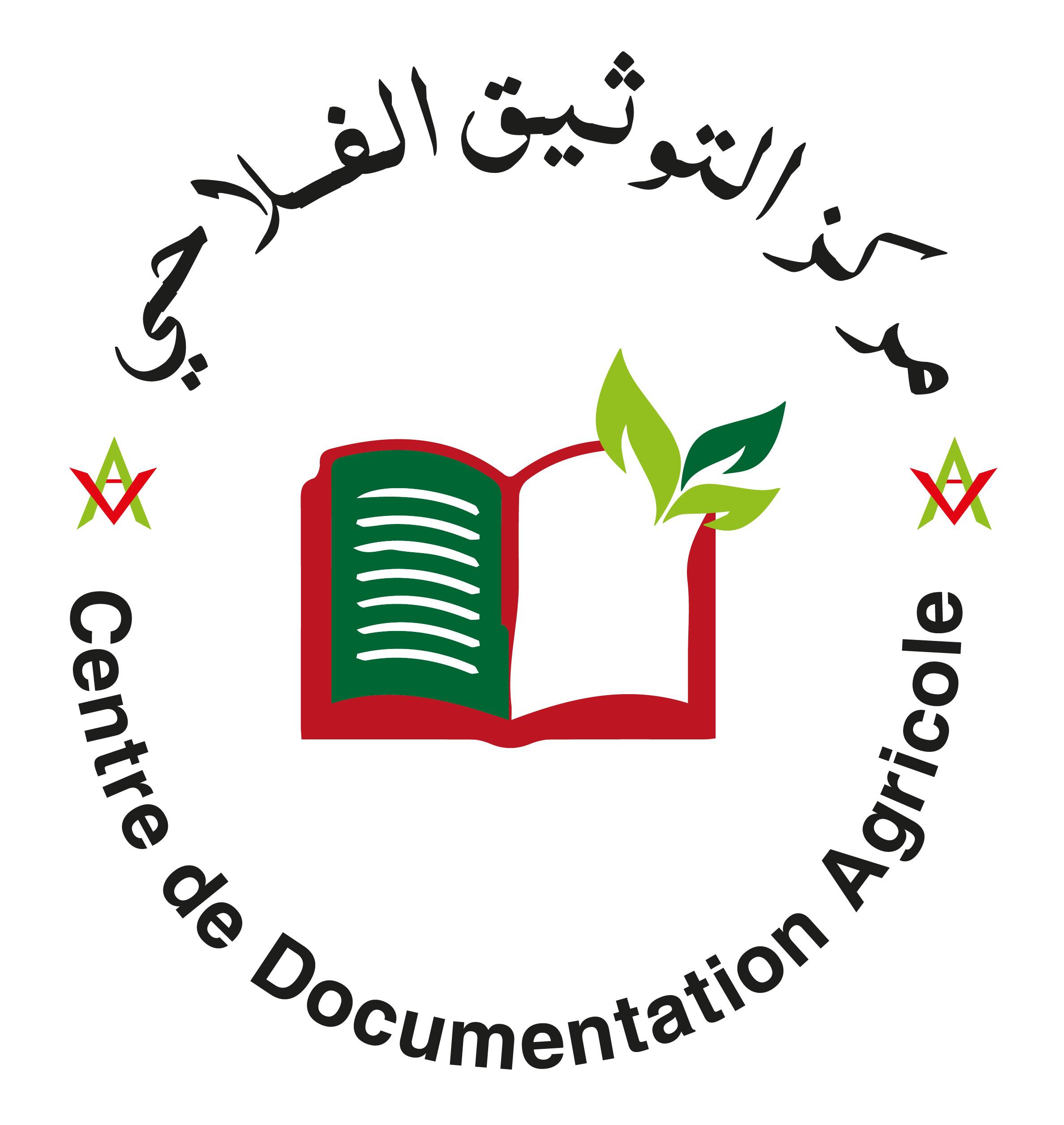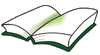|
Résumé :
|
Le bassin du Couesnon, est marqué par une fragilité de ses ressources actuelles. Cette situation risque de s'aggraver avec les impacts du changement climatique. Au regard de ces problématiques, se pose la question de la disponibilité de la ressource en eau pour les usagers, mais également pour la préservation des milieux aquatiques. L’analyse HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat) a pour objectif d’améliorer la gestion de l’eau sur le bassin versant du Couesnon en tenant compte des quatre volets. La présente étude vise, dans un premier temps, à contribuer au volet hydrologie de l’étude HMUC, notamment à travers la modélisation hydrologique et le calcul des débits de référence des cours d'eau. Elle consiste, également à traiter les volets Usages et Climat. Ces deux phases serviront de base pour, dans un second temps, réaliser la modélisation d’allocation des ressources via le logiciel WEAP « Water Evaluation And Planning System », intégrant les quatre volets (hydrologie, milieux, usage, climat). Ceci permettra de dresser un état des lieux actuel du bassin et d’anticiper les perspectives pour les deux horizons futurs 2030 et 2040. Les résultats de la modélisation hydrologique par GR4J avec les paramètres de calage et Sunshine montrent que le débit moyen annuel est de 4,62 m³/s pour le Couesnon à Romazy, 0,64 m³/s pour le Nançon, et 0,76 m³/s pour la Loisance. Pour les prélèvements d’eau, une consommation nette annuelle de 12 millions de m³ est observée sur la période 2010-2023, avec une augmentation prévue dans les décennies à venir. L’exploitation des résultats Explore 2, notamment du scénario climatique RCP8.5 permet de mettre en évidence une diminution des ressources en eau pouvant atteindre -40 % du module à l'horizon 2100, accompagnée d’un allongement des périodes d’étiage. Les précipitations actuelles varient entre 818 et 909 mm/an (SAFRAN), avec une diminution projetée de 15 % à 18 % d’ici 2100. Les températures devraient augmenter de +1,6°C à +3,2°C d'ici 2070-2100, avec un réchauffement plus marqué dans la partie amont du bassin. Le modèle WEAP, montre que le débit minimum biologique (DB) est satisfait avec un minimum de 90 % et que l'impact des prélèvements sur les cours d'eau reste modéré. Ces résultats guideront l’élaboration de plans d’action pour une gestion durable de l'eau, aidant la Commission Locale de l’Eau (CLE) à définir des volumes prélevables (VP), des débits objectifs d’étiage (DOE).
|