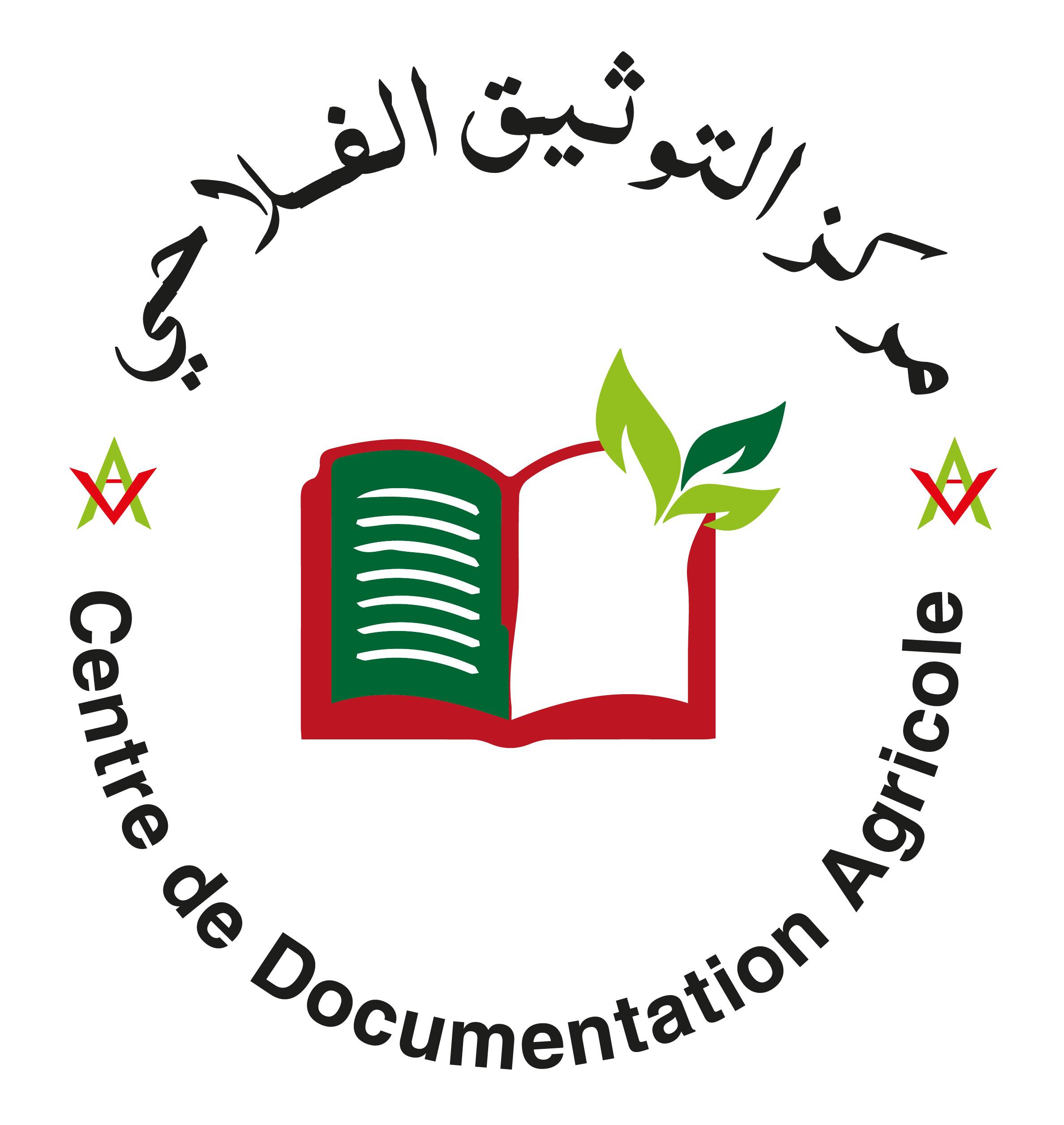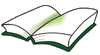| Titre : | Étude des mammites subcliniques chez la chamelle (Camelus dromedarius) et leurs impacts sur la qualité hygiénique du lait au Maroc |
| Auteurs : | HMYTI Abdessamad, Auteur ; SGHIRI Abdelmalek, Auteur ; ADNANE Anass, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2024 |
| Format : | 153 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | conduite d’élevage ; lait de chamelle ; mammite subclinique ; analyse bactériologique ; qualité hygiénique. |
| Résumé : |
La mammite clinique en général et la mammite subclinique en particulier posent une contrainte importante pour le secteur laitier chez le dromadaire. En effet, notre étude porte sur les mammites subcliniques chez la chamelle et la qualité hygiénique de son lait. En effet
Notre étude a été réalisée sur une période de treize mois, dans quatre sites différents, Rabat (Ain-Aouda), Casablanca (Had Soualem), Guelmim-Oued Noun, Taroudant et Massa. Elle s’est intéressée d’abord à la conduite d’élevage, aux conditions de la traite et à la destination du lait produit. Après un examen rapide de la mamelle et de sa conformation, le test CMT (California Mastitis Test) est effectué pour le dépistage des mammites subcliniques. Les quartiers présentant une mammite subclinique (réaction positive au CMT) sont pris en considération pour la recherche des bactéries dans le lait et pour évaluer sa qualité hygiénique. Cette dernière est basée sur le dénombrement de la Flore Mésophile Aérobie Totale (FMAT), des Coliformes Totaux (CT), des Coliformes Fécaux (CF) et des Staphylocoques Présumés Pathogènes (SPP). Au total, 16 élevages ont été visités, 90 chamelles sollicitées et 360 quartiers examinés puis soumis au dépistage des mammites subcliniques par le biais du CMT. Il en résulte que 74 quartiers sont atteints ensuite 61 échantillons de lait sont à nouveau prélevés à partir de ces quartiers affectés pour les besoins des analyses bactériologiques. Parmi les 16 élevages étudiés, 75% (12/16) sont situés en zones périurbaines et produisent du lait destiné principalement à la vente directe aux consommateurs, tandis que 25% (4/16) sont transhumants et réservent leur production à l'autoconsommation. Concernant la gestion des mâles reproducteurs, 62,5% (10/16) des élevages ne possèdent qu'un seul géniteur contre 37,5% (6/16) qui en comptent deux. Les pratiques alimentaires varient également, 37,5% (6/16) des élevages ne pratiquent pas de supplémentation lorsque les animaux sont au pâturage, tandis que 50% (8/16) assurent une supplémentation continue et 12,5% (2/16) la consacrent exclusivement aux périodes de lactation, ciblant des fois tout le troupeau ou seulement les femelles en lactation. La saison de reproduction diffère selon les éleveurs ; certains la débutent au mois de Septembre et la terminent au mois d’Avril, tandis que d'autres la commencent au mois d’Octobre ou Novembre. Pendant cette période, le mâle reste, dans la majorité des cas, en permanence avec les femelles. Concernant la traite, 32% (5/16) des élevages effectuent une seule traite par jour, généralement tôt le matin, alors que 56% (9/16) réalisent deux traites (matin et soir). Les résultats du CMT ont révélé une prévalence des mammites subcliniques à l’échelle individuelle estimée à 40% chez les chamelles examinées et à 20,55% à l’échelle des quartiers atteints. La région de Rabat (Ain-Aouda) a enregistré la prévalence la plus élevée 87,5 (7/8), suivie de Casablanca (Had Soualem) 57,2% (5/7), de Guelmim-Oued Noun 37,7% (26/69) et de Souss-Massa 20% (1/5). Les quartiers postérieurs, en particulier le gauche, ainsi que l’antérieur et le postérieur gauche, sont les plus fréquemment touchés. Par ailleurs, 72,2% des femelles atteintes présentent au maximum deux quartiers affectés. Une prévalence plus élevée a été observée chez les femelles en début de lactation (58%) ainsi que chez les chamelles âgées de 5 à 10 ans (50%). L’examen bactériologique a révélé que 29,5% des prélèvements de lait sont négatifs. Ainsi, plusieurs agents pathogènes ont été identifiés avec des prévalences respectives variables comme Staphylococcus aureus (36%), Streptococcus spp. (39%), entérobactéries (15%) incluant Klebsiella pneumoniae (8,2%), Escherichia albertii (1,9%) et Kluyvera ascorbata (4,9%), Moraxella spp. (3,3%), Listeria monocytogenes (3,3%) et Corynebacterium spp. (3,3%). Les charges bactériennes moyennes observées étaient les suivantes : FMAT : 4,1 × 10⁸ UFC/ml, CT : 3,9 × 10⁵ UFC/ml, CF : 7,1 × 10⁵ UFC/ml et staphylocoques présumés pathogènes : 1,3 × 10⁶ UFC/ml. |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/HMYTI_Abdessamad_2024.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200041538 | 10468 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Docteur vétérinaire | Consultation sur place Exclu du prêt |