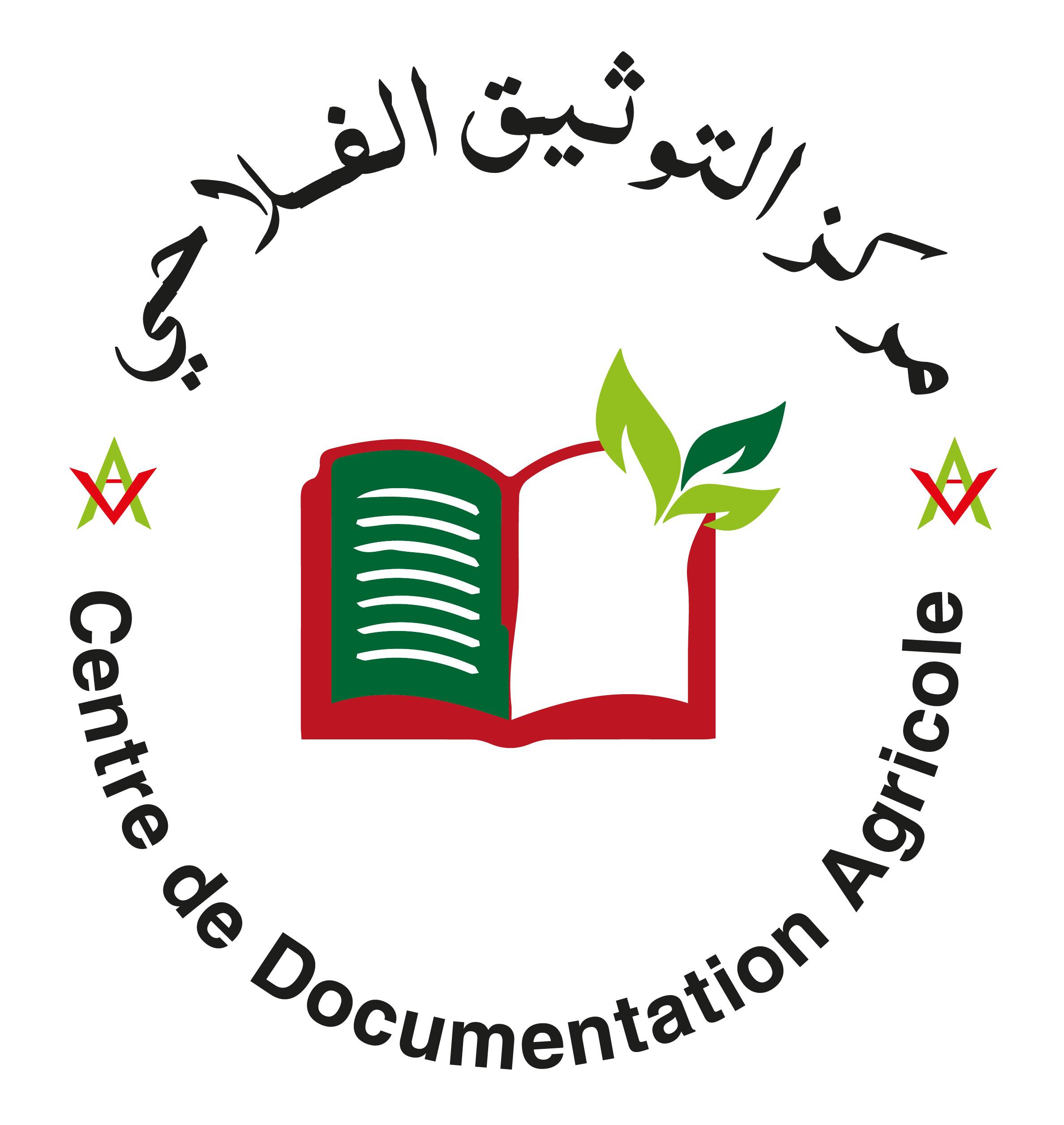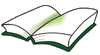|
Résumé :
|
Le territoire de Dayet Aoua, marqué par une diversité agricole et une forte dépendance aux subventions publiques, illustre bien les défis de la durabilité des pratiques agricoles dans une région aux ressources naturelles limitées et précieuses. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet NATAE, qui vise à encourager la transition agroécologique en diffusant les pratiques les plus prometteuses. L'objectif principal de cette étude est d'analyser la viabilité des exploitations agricoles dans le territoire de Dayet Aoua et de déterminer l'impact des politiques de subventions sur cette viabilité, qu'il soit positif ou négatif. Pour ce faire, une typologie des exploitations a été établie à partir de 71 enquêtes menées selon une méthode en boule de neige. L'approche AFDM a été utilisée pour identifier les différents types d'exploitations. Les données recueillies ont permis de détailler la structure des exploitations, les types de cultures, l'accès aux subventions, et les pratiques agricoles. L’étude a identifié trois principales typologies d'exploitations : les exploitations familiales diversifiées, celles centrées sur la monoculture intensive du pommier, et celles en voie d'intensification. Le revenu moyen varie selon le type d’exploitation, avec un revenu moyen de 343 905,41 DH/ha pour les exploitations intensives de pommiers, qui génèrent les revenus les plus élevés. Les analyses de régression linéaire multiple ont montré que la taille de l'exploitation est le principal facteur influençant positivement le revenu agricole. Concernant la viabilité sociale, l'étude révèle une prédominance de la main-d'oeuvre externe, surtout dans les exploitations intensives. La pluriactivité, souvent adoptée par les exploitations familiales pour compenser un revenu agricole insuffisant, est influencée par l'expérience de l'agriculteur, son niveau d'instruction et son âge. Ces mêmes variables impactent la volonté de transmettre l'exploitation, bien que ce ne soit pas avec la même significativité ni dans le même sens, cependant cette transmissibilité n’est plus une priorité pour les exploitants du territoire. Les résultats montrent que l'accès aux subventions est un facteur clé de la viabilité économique, particulièrement influencé positivement par l'augmentation des superficies de pommiers. Toutefois, ces subventions ont aussi des effets néfastes sur la viabilité environnementale, notamment par la surexploitation des ressources en eau. L'étude comparative avec le territoire de M’semrir-Tilmi a mis en évidence que, bien que les subventions augmentent les revenus à court terme, elles entraînent une dégradation environnementale accrue, compromettant ainsi la viabilité à long terme des exploitations. Pour faire face à ces défis, l'étude souligne les stratégies adoptées par les différents types d'exploitations et propose l'adoption de solutions agroécologiques permettant de maintenir un gain économique tout en assurant la durabilité.
|