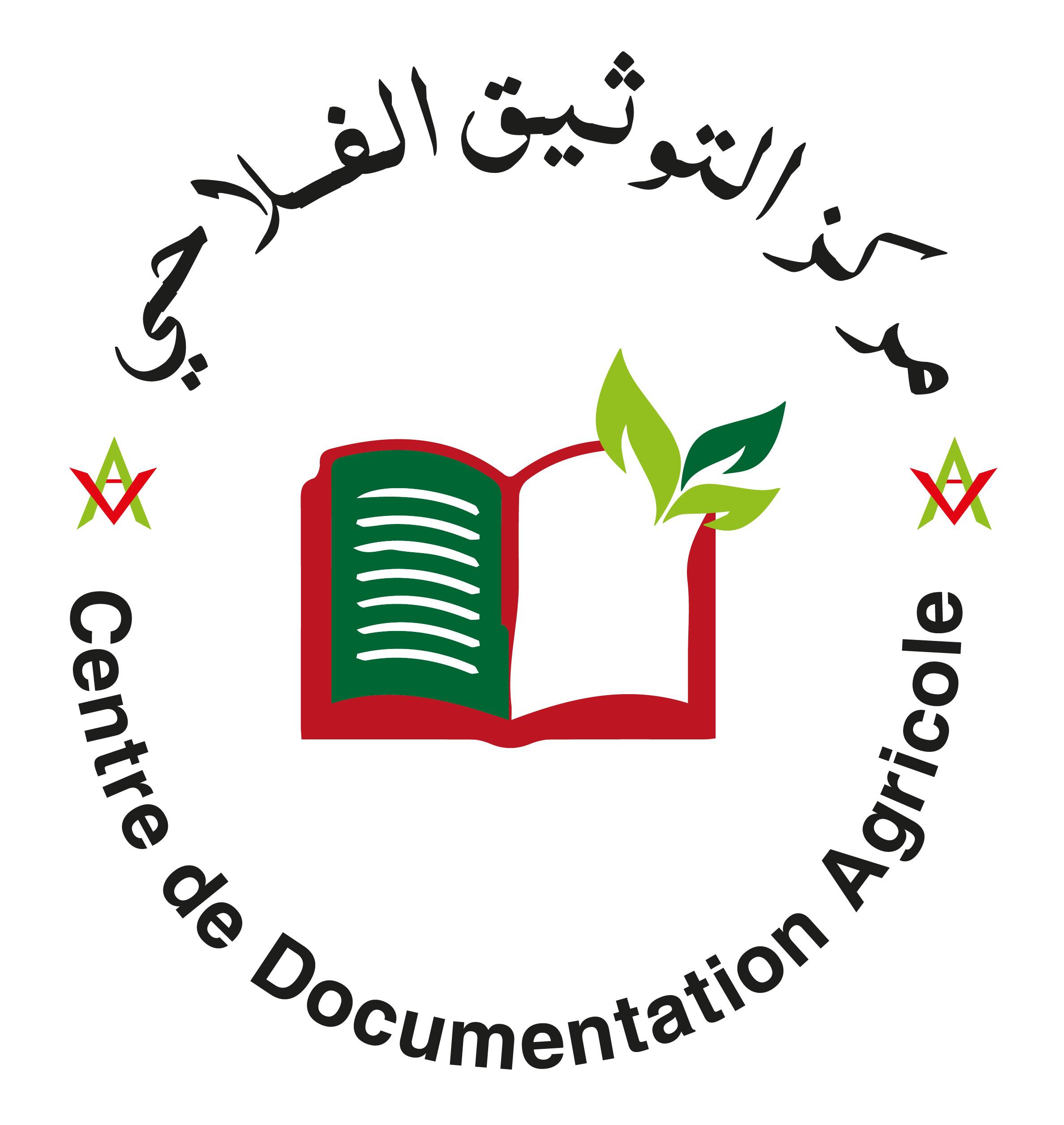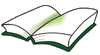|
Résumé :
|
L’agriculture familiale dans les oasis de montagne est confrontée à une multitude de défis, allant des caractéristiques géographiques et climatiques de ces régions aux conditions socio-économiques. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet « Massire », dont l’objectif est de renforcer les capacités des zones vulnérables en vue d’assurer un développement durable du territoire. Dans ce contexte, notre étude se concentre sur l’analyse de la viabilité et les stratégies d’adaptation optés par les agriculteurs, un enjeu majeur pour un développement durable des oasis, en particulier dans notre zone d’intervention, les communes de M’semrir et Tilmi. Ceci est basé sur l’examen de 75 enquêtes menées auprès les agriculteurs suite à un échantillonnage stratifié. Les résultats ont permis d’identifier trois classes d’exploitations, chacune faisant l’objet d’une analyse détaillée de leur viabilité économique et sociale. Le premier type (T1) est axé sur un élevage pastoral et une agriculture vivrière. Bien que ce type génère en moyenne un revenu agricole annuel de 105 492 DH, les défis associés à cette classe mettent en question sa viabilité à long terme. Le deuxième type (T2), qui représente les petites et moyennes exploitations, le plus dominant dans la zone d’étude, peine à générer un revenu agricole décent, avec une moyenne de 16 434 DH par an, ne dépassant pas le SMAG et insuffisant pour subvenir aux besoins essentiels du ménage. Le troisième type (T3), correspondant aux grandes exploitations orientées vers une intensification de la culture du pommier, réalise en moyenne un revenu de 83 214 DH par an. Une régression linéaire multiple a été employée pour éclairer ces disparités de revenus. Il en ressort que la superficie, l’effectif du cheptel et l’appartenance à une organisation professionnelle sont les principaux déterminants. L’analyse de la viabilité sociale a exploré la capacité de ces exploitations à générer du travail, familial ou externe, ainsi que l’importance des revenus non agricoles. Les types T1 et T3 mobilisent plus de maind’œuvre que le type T2, avec une moyenne de 766 jours/an pour T1, 112 jours/an pour T3 et 47jours/an pour T2. L’analyse des revenus non agricoles a révélé une dépendance envers ces revenus pour les types T2 et T3 allant jusqu’à 90% du revenu total. Afin de comprendre les motivations des chefs de ménage à se tourner vers d’autres activités, une analyse de régression logistique a été réalisée. Les résultats ont indiqué un effet négatif d’âge, des transferts financiers et d’effectif du cheptel. Face à la faible rentabilité agricole, les exploitants ont adopté diverses stratégies qui ont a eu un impact sur le fonctionnement et la viabilité de ces exploitations.
|